Accueil > TGBSF > A- > Averoigne et autres mondes
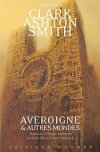 Averoigne et autres mondes
Averoigne et autres mondes
dimanche 8 mars 2020, par
Clark Ashton SMITH (1893-1961)
Etats-Unis, années 1930
Mnémos, coll. "Intégrales", 2018, 240 pages, traductions de Julien Bétan et Alex Nikolavitch.
Parmi ses rééditions devenues une des marques de fabrique de la maison, Mnémos propose régulièrement des publications d’importance. La série de volumes consacrés à l’œuvre de Clark Ashton Smith, membre du petit cercle des lovecraftiens de la première heure, est de celles-là : tous les textes ont en effet été retraduits, et sont enrichis de préface ou de postface. Après Zothique, Hyperborée et Poséidonis, voici donc Averoigne, une région lointainement inspirée de l’Auvergne, en pleine époque médiévale (entre le XIe et le XVe siècle, pour être précis). Dans ce monde constellé de monastères et de châteaux, dont le centre est la ville-cathédrale de Vyônes, Clark Ashton Smith met en scène des personnages souvent emportés par des malédictions plus anciennes que le christianisme en apparence souverain.
Après « Averoigne », un poème servant d’ouverture au cycle, « La fin de l’histoire » témoigne d’emblée de tout le savoir-faire de l’écrivain : un mystérieux volume caché dans une abbaye, un homme qui succombe à son appel, sa découverte d’un monde caché reproduisant celui d’une Grèce antique mythique, et la chute, qui témoigne en réalité de l’emprise profonde d’une créature maléfique… « Le satyre » est relativement classique et prévisible, tout comme « La mère des crapauds », « L’enchanteresse de Sylaire », « Un rendez-vous en Averoigne » et son couple de vampires, ou « Les mandragores » et son meurtre passionnel. Plus notable, « Le faiseur de gargouilles » présente un sculpteur génial, amoureux malheureux, dont les créations cristallisent toutes les rancoeurs, tous les désirs enfouis, son inconscient, en somme.
« Saint Azédarac », plein de rouerie, joue avec le principe du voyage dans le temps, la malédiction d’un sorcier séculaire s’abattant sur un jeune clerc… pour son plus grand plaisir charnel ! « La Vénus exhumée » confronte elle aussi des moines pleins de candeur à une attraction sexuelle antique, que le christianisme tenta de mettre sous le boisseau. « Le colosse d’Ylourgne », qui décline une nouvelle fois le thème du sorcier maléfique, le fait avec un rendu très visuel, digne d’un blockbuster de fantasy. Plus original, « La bête d’Averoigne » est assurément un des meilleurs récits de cet ensemble thématique : structure éclatée en divers témoignages, créature agissant en Averoigne sous l’œil d’une comète, mystère maintenu sur certains aspects de la résolution de l’énigme… Un bien beau texte lovecraftien.
Tous ces contes morbides, qui m’évoquent fortement les images des albums de Servais, que je lisais en bibliothèque durant mon enfance, sont autant de démonstrations d’une empreinte finalement superficielle du christianisme, auquel survivent des traces puissantes de paganisme, tout particulièrement dans ces forêts qui symbolisent depuis fort longtemps la nature sauvage face à la civilisation (voir Une histoire de la forêt de Martine Chalvet). On sent également toute l’imprégnation d’une vision désormais datée des sorcières : dans ces récits, les femmes sont souvent lubriques et manipulatrices, la sorcellerie exclusivement négative, loin du regard actuel où la chasse aux sorcières s’apparente à la fois à une offensive patriarcale et capitaliste (voir les travaux de Silvia Federici, en particulier Caliban et la sorcière). Des résumés d’histoires que Clark Ashton Smith n’a jamais écrites complètent ce très bel ensemble.
L’autre moitié du recueil, intitulée Autres mondes, évoque d’autres lieux, tout aussi hantés. Une Mars colonisée, proche de ces territoires inconnus d’Asie ou d’Afrique repris par un Paul-Martin Gal, est ainsi le cadre d’histoires particulièrement frappantes et marquantes. « Les caveaux de Yoh-Vombis » en est une sorte d’apex, glaçant compte-rendu d’une expédition archéologique menée dans les ruines d’une ville où subsistent des horreurs immémoriales. Un texte qui s’inscrit au fer rouge dans l’esprit. « L’habitant du gouffre » est d’une veine semblable, à peine moins effrayant, exposant un culte chtonien dans les entrailles de Mars, aux sectateurs marqués dans leur chair... « Vulthoom » se rapproche davantage de l’ambiance pulps, avec sa créature extra-terrestre désireuse de dominer la Terre ; la fin se distingue néanmoins par son caractère sacrificiel.
Une planète plus étrangère, Xiccarph, est également évoquée le temps de deux histoires mettant en scène un autre sorcier, Maal-Dweb. « Le dédale de Maal-Dweb » présente un amoureux déçu tenter de s’en prendre à lui, qui collectionne les femmes et leurs émotions, en vain bien sûr. « Les femmes-fleurs » voit à l’inverse le nécromant partir à l’aventure, et se confronter à des alter-egos reptiliens. Si le style de Smith est toujours reconnaissable, avec ses descriptions immersives et son langage fleuri, esthétisant, ces histoires ne brillent pas vraiment par leur originalité.
Dans d’autres mondes encore, « Les abominations de Yondo » voient un hérétique exilé dans un désert aux mille horreurs, qui le poussent à préférer succomber aux mains des inquisiteurs (encore une pique lancée vers les religions et leur intolérance). « Une nuit dans Malnéant » est plus marquant, une évocation pleine de force du deuil et de la culpabilité que l’on peut ressentir à l’égard du disparu. « Le monstre de la prophétie » relève plus directement de la science-fiction, face à une fantasy dominante : un extra-terrestre en visite sur Terre en extrait un poète aux pulsions suicidaires afin de réaliser une antique prophétie lui permettant de conquérir le pouvoir. Plein d’inventivité et d’images fortes, ce texte s’avère singulier, mais sa fin se révèle trop abrupte. « Le démon de la fleur » explore de nouveau le thème de la vie végétale, dans un cadre qui évoque les civilisations précolombiennes ; une malédiction qui prouve, une fois de plus, la dérisoire capacité de l’humain à infléchir le destin. « La planète défunte », dernière nouvelle du recueil, est un poignant récit de fin d’un monde, vécu par un astronome amateur par projection de son esprit dans celui d’un amant crépusculaire.
Averoigne et autres mondes est complété par plusieurs poèmes en prose, centrés sur l’entropie et son caractère implacable, ainsi que par une postface de Samuel T. Joshi, biographe en chef de H.P. Lovecraft. Pour singer la formule de Jean-François Vilar, aux côtés de Clark Ashton Smith, nous cheminons entourés d’horreurs innommées, d’amours charnels qui ne sont que d’éphémères refuges face à l’emprise toute puissante de la mort.
 Wagoo
Wagoo