Accueil > TGBSF > P- > Un paysage du temps
 Un paysage du temps
Un paysage du temps
dimanche 15 décembre 2019, par
Gregory BENFORD (1941-)
Etats-Unis, 1980, Timescape
Folio, 2001,
Honoré de deux prix - le British Science Fiction en 1980 et le John-Wood-Campbell Memorial en 1981 -, cité en 1993 par Lorris Murail dans Les maîtres de la science-fiction comme le titre de référence de Gregory Benford, puis l’année suivante dans la bibliothèque idéale du science-fictionnaire par Stan Barets, Un paysage du temps a en outre la particularité d’avoir été publié directement en format poche dans la fameuse collection Présence du futur de Denoël et ce dès l’année suivant sa parution. A priori, voilà qui remplit les critères pour le désigner comme un classique, ou suffit au moins à le désigner comme un must, d’autant que, critère personnel, il traite de voyage temporel. Alors pourquoi avoir tant attendu me direz-vous ? Hé bien, essentiellement parce que mes deux lectures antérieures de Gregory Benford ne m’avaient pas emballé, souffrant d’une avancée dans le récit un peu poussive en dépit de bonnes idées. Cédant cependant à une impulsion, je me suis laissé aller à contempler le paysage...
De prime abord, ce paysage devrait plutôt être de Constable, l’action démarrant initialement à Cambridge en 1998, dans un laboratoire où un Anglais, Renfrew, et un
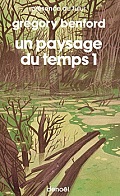 Américain, Greg Markham, travaillent à envoyer un message dans le passé via les flux de tachyons, des particules supraluminiques, dans le but d’alerter l’humanité de la catastrophe qui se développe en cette fin de XXe siècle. A l’autre bout du flux, en 1962, à l’université de La Jolla, Gordon Bernstein et son assistant découvrent en travaillant sur la résonance de l’antimoniure d’indium des perturbations électromagnétiques qui se révèlent être un message en morse. Il faudra à l’équipe californienne plusieurs mois pour comprendre d’où vient le message, - un temps il est question d’extra-terrestre - et pour en faire admettre la véracité à la communauté scientifique américaine en générale et d’abord à celle de l’université en particulier.
Américain, Greg Markham, travaillent à envoyer un message dans le passé via les flux de tachyons, des particules supraluminiques, dans le but d’alerter l’humanité de la catastrophe qui se développe en cette fin de XXe siècle. A l’autre bout du flux, en 1962, à l’université de La Jolla, Gordon Bernstein et son assistant découvrent en travaillant sur la résonance de l’antimoniure d’indium des perturbations électromagnétiques qui se révèlent être un message en morse. Il faudra à l’équipe californienne plusieurs mois pour comprendre d’où vient le message, - un temps il est question d’extra-terrestre - et pour en faire admettre la véracité à la communauté scientifique américaine en générale et d’abord à celle de l’université en particulier.
En fait l’intrigue relève plutôt du pointillisme et le lecteur se demande longtemps ce qui seurat. La situation de crise régnante à la fin du siècle est en effet mise en place par touches, relatives essentiellement aux conditions de vie qui se dégradent (problèmes d’alimentation, coupure d’électricité...) et à l’existence d’une floraison végétale invasive dans l’océan atlantique. Au fil de l’alternance des chapitres, le lecteur découvre des allusions à des événements historiques relevant maintenant de l’uchronie, et apprend que la crise marine se propage. Il assiste au lent naufrage du monde à cause des excès de l’agriculture industrielle. En un sens, Un paysage du temps n’est pas exempt de prophétie et s’inscrit bien dans la veine des romans de la décennie qui précède sa rédaction.
Reste qu’il demeure un roman ancré dans la science, une référence dans la hard science fiction, à propos de laquelle Jacques Sadoul a pu écrire que les expériences étaient racontée de manière crédible et que le roman constituait une réflexion brillante et talentueuse sur le temps [1]. Tellement brillante que le lecteur que je suis s’est perdu dans une grande partie du fil des explications, ne comprenant que l’idée de divergence temporelle quantique.
Fort heureusement, Un paysage du temps ne se limite pas cette dimension (il y en a forcément plusieurs vu la conception du temps qui s’y impose...). C’est aussi un récit sur le monde de la recherche avec ses difficultés à trouver un financement, ses
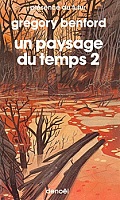 mesquineries, ses mandarins. Ça sent le vécu pourrait-on dire. Les personnages sont aussi assez finement décrits avec leurs qualités et leurs défauts, à commencer par Gordon Bernstein et son lot de complexes incarnés par ses rapports avec sa mère juive. De manière étonnante, mais pas déplaisante, le récit est très porté sur le sexe, Berstein vivant dans le péché avec une goy, relation dont j’ai cherché à comprendre tout au long de l’histoire si elle avait des ressorts autres que sexuels. En 1998, le personnage le plus torturé serait Ian Peterson, membre du gouvernement, mais comme il saute tout ce qui porte jupons, avec ou sans alliance, pour un peu qu’elles aient du charme, et qu’il détient un pouvoir immense, il tient plus du bourreau que de la victime.
mesquineries, ses mandarins. Ça sent le vécu pourrait-on dire. Les personnages sont aussi assez finement décrits avec leurs qualités et leurs défauts, à commencer par Gordon Bernstein et son lot de complexes incarnés par ses rapports avec sa mère juive. De manière étonnante, mais pas déplaisante, le récit est très porté sur le sexe, Berstein vivant dans le péché avec une goy, relation dont j’ai cherché à comprendre tout au long de l’histoire si elle avait des ressorts autres que sexuels. En 1998, le personnage le plus torturé serait Ian Peterson, membre du gouvernement, mais comme il saute tout ce qui porte jupons, avec ou sans alliance, pour un peu qu’elles aient du charme, et qu’il détient un pouvoir immense, il tient plus du bourreau que de la victime.
En tant qu’histoire de voyage dans le temps, le roman de Benford est largement surclassé par de nombreux autres romans, d’autant que le concept de paradoxe temporel y retombe à plat et qu’il ne parvient pas à éviter l’écueil du 22 novembre 1963, même si on peut comprendre, compte tenu de la génération de l’auteur et de la date de rédaction, qu’il n’ait pas encore surmonté le traumatisme de l’assassinat de Kennedy. Dans la mesure où cet événement n’est pas nécessaire à l’intrigue, sa modification n’étant que la manifestation de la divergence, n’eut-il pas été possible d’en trouver un autre ?
En définitive, je ne regrette pas d’avoir lu Un paysage du temps, mais si je ne suis pas vraiment déçu, je ne trouve pas qu’il y ait motif à le porter au pinacle. Un scientifique aurait sans doute matière à ne pas être d’accord avec moi cependant...
[1] Jacques Sadoul, Histoire de la science-fiction moderne, p.354-355.
 Wagoo
Wagoo