Scénario : Gail SIMONE (1974)
Dessins : Walter GEOVANI (1983-)
États-Unis, 2014-2015, Red Sonja : the forgiving of monsters
Graph Zeppelin, 2024, 160 p.
Le pardon des monstres marque la conclusion de la trilogie créée par Gail Simone et Walter Geovani, une revisitation parfaitement réussie du mythe de Red Sonja. De ces six nouveaux épisodes, les quatre premiers forment un arc narratif complet. Partie châtier un vilain sorcier, responsable de la mort de plusieurs villageois, la diablesse (...)
En tant que steward du Wagoo je vous souhaite la bienvenue à bord !
Bon d’accord, je vois à votre regard dépité que ça ne correspond pas tout à fait à votre attente. Certes la navigation sur ce site est basique, la déco minimaliste mais le trajet jusque la Terre ne dure pas longtemps, même avec ce vaisseau à propulsion infra-luminique.
Les banques de données sont bien fournies. Vous pourrez vous y retrouver en utilisant les fichiers alphabétiques de la cinecstasy ou de la TGBSF (Très grande bibliothèque de science-fiction… du moins elle sera grande quand elle sera remplie) ou la recherche par mot-clé.
Pour les autres, je vous rassure le bar est ouvert en permanence et notre robot i-zac se fera un plaisir de vous servir ! Un petit conseil évitez son virgin cuba libre…
Articles les plus récents
-
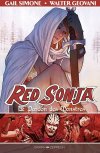
Red Sonja. Le pardon des monstres
9 mars, par Maestro -

Batman année un
9 mars, par von BekScénario : Frank MILLER (1957-)
Dessins : David MAZZUCCHELLI (1960-)
États-Unis, Year One, 1987
En fusionnant différentes continuités du multivers, La crise des Terres infinies a permis la réécriture des mythes fondateurs des personnages de DC. Si John Byrne a été chargé des origines de Superman, c’est Frank Miller, fort du succès de son Dark Knight Returns en 1986, qui reçoit le feu vert pour celles de Batman, une œuvre d’autant plus nécessaire que l’histoire du (...) -
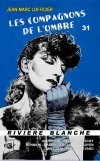
Les Compagnons de l’ombre - 31
2 mars, par MaestroJean-Marc LOFFICIER (sdd)
France, 2024
Black Coat Press, coll. « Rivière blanche », série Noire, 270 p.
C’est la dernière ligne droite pour Les Compagnons de l’ombre, cette série unique en son genre de par la multiplicité des appariements réalisés, puisant dans toutes les cultures de l’imaginaire. Encore quelques tomes, et ils tireront leur révérence. Profitons donc de ces ultimes salves. On retrouve ainsi Rick Lai qui, dans « Le pistolero au masque de fer », amusant (...) -
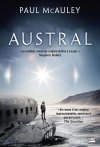
Austral
23 février, par von BekPaul J. McAULEY (1955-)
Grande-Bretagne, 2017, Austral
Bragelonne, 2022, 384 p.
A priori, je suis fâché avec Paul McAuley, enfin plutôt avec ses livres bien évidemment. Trois livres lusCowboy Angels, Une invasion martienne et La Guerre tranquille ont donné à ce jours trois déceptions qui s’était traduites par deux chroniques peu élogieuses. Globalement, je lui reproche trois choses : un substrat scientifique trop indigeste dans Une invasion martienne, le caractère politique peu (...) -
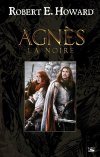
Agnès la Noire
23 février, par MaestroRobert HOWARD (1906-1936)
États-Unis, 1934-2011
Bragelonne, coll. « Les Intégrales », 2014, 528 p..
À côté de la trilogie de récits fantastiques et de fantasy écrits hors de ses cycles emblématiques, composée des Dieux de Bal-Sagoth, des Ombres de Canaan et Almuric, Agnès la Noire se penche sur les fictions à connotation historique d’Howard.
À commencer par l’ensemble des aventures d’Agnès de Chastillon, qui a donné son titre au recueil. Agnès est une jeune paysanne, (...) -
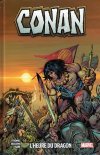
Conan : l’heure du dragon
16 février, par MaestroScénario : Roy THOMAS (1940-)
Dessins : Gil KANE (1926-2000) et John BUSCEMA (1927-2002)
États-Unis, 1973-1974
Panini Comics, 2021, 272 p., traduction de Thomas Davier et Geneviève Coulomb.
L’Heure du dragon est l’unique roman de Robert Howard mettant en scène son personnage emblématique de Conan. Écrit à l’origine pour un éditeur britannique désireux de lancer le Cimmérien sur son marché national, il ne put y être publié pour cause de faillite, finissant dans les (...) -

Justice League : crise d’identité
9 février, par von BekScénario : Brad MELTZER (1970-), Geoff JOHNS (1973-) & Gerry CONWAY (1952-)
Dessins : Rags MORALES (1966-), Dave GIBBONS (1949-), Dick DILLIN (1928-1980) & Frank McLAUGHLIN (1935-2020)
États-Unis, 2004-2005
Panini Comics, 2005 pour la première édition française
J’ai mis la charrue avant les bœufs. Que vous lisiez La crise infinie ou 52, il est toujours une référence qui surgit, celle de Crise d’identité : elle est à l’origine de la fragmentation de la (...) -
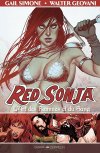
Red Sonja. L’art des flammes et du sang
9 février, par MaestroScénario : Gail SIMONE (1974-).
Dessins : Walter GEOVANI (1983-)
États-Unis, 2014, Red Sonja : the Art of Blood and Fire
Graph Zeppelin, 2024, 168 p.
L’art des flammes et du sang est le second volume dédié aux nouvelles aventures de Sonja la rousse, scénarisées par la talentueuse Gail Simone, qui n’hésite pas à revisiter le personnage iconique. Les six segments dont il est ici question sont reliés par le principe d’une quête, classique mais efficace. En (...) -

Conan
2 février, par MaestroMarcus NISPEL (1963-)
États-Unis, 2011, Conan The Barbarian
Avec Jason Momoa, Rachel Nichols, Stephen Lang, Rose McGowan, Ron Perlman, Nonso Anozie.
Dans l’histoire des adaptations cinématographiques du célèbre héros créé par Robert Howard et largement popularisé par les comics de Marvel, seule la première a généralement droit aux honneurs. Non que le film de John Milius soit un modèle de respect de l’œuvre originelle, bien au contraire ; mais sa dimension épique, la (...) -
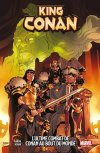
King Conan : l’ultime combat de Conan au bout du monde
26 janvier, par MaestroScénario : Jason AARON
Dessins : Mahmud ASRAR
États-Unis, 2022
Panini Comics, 2022, 144 p. traduction de Thomas Davier.
L’époque durant laquelle Conan est devenue roi d’Aquilonie offre un narratif à part entière. Les problématiques ont changé, son statut familial également, et cette extrémité de son existence permet de surplomber un riche passé. Le duo Aaron / Asrar, déjà auteur du diptyque Vie et mort de Conan / Les enfants de la mort rouge, s’est surpassé pour cet (...)
page précédente | page suivante
 Wagoo
Wagoo
Derniers commentaires