Accueil > TGBSF > S- > La Science-fiction allemande. Etrangers à Utopolis
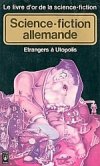 La Science-fiction allemande. Etrangers à Utopolis
La Science-fiction allemande. Etrangers à Utopolis
Deutsche Qualität !
samedi 26 septembre 2015, par
Daniel WALTHER (1940-) , dir.,
France, 1980
Pocket, coll. "Le livre d’or de la science-fiction", 288 p.
Dans cette véritable mine qu’est la collection du « Livre d’or de la science-fiction », les anthologies nationales sont parmi les plus intéressantes, l’idée étant reprise une vingtaine d’années plus tard par Rivière blanche. Outre l’URSS et l’Italie, l’Allemagne -en réalité la RFA pour la période d’après-guerre- eut droit à un salutaire éclairage grâce à Daniel Walther. Ce dernier se fend d’une introduction détaillée, « S.F. made in Germany », titre qui veut montrer la forte influence de la science-fiction étatsunienne depuis 1945, après pourtant une première science-fiction allemande (disons avant l’avènement du nazisme) forte de sa personnalité propre, à l’instar de sa voisine française. Ses avis sont souvent tranchés (il déteste Perry Rhodan !), mais toujours stimulants.
Sur les seize nouvelles retenues, seules les deux premières appartiennent à la fin du XIXe et au début du XXe siècles. « Sur la bulle de savon » (1887), de Kurd Laszwitz, est un très beau texte de merveilleux scientifique, au sens premier de l’expression, réflexion très habile et élégante sur la relativité des perceptions et de la vie, qui est en même temps critique des pensées à œillères (religieuses ou autres), incapable de voir l’infini de l’univers. « Rakkox le milliardaire » (1900), de Paul Scheerbart, est plus baroque, plus loufoque avec ses nombreuses inventions, son personnage de milliardaire prêt à toutes les excentricités se retrouvant en guerre contre la Chine, pouvant être lu comme une condamnation de la concurrence et des rivalités impérialistes propres au capitalisme.
On fait ensuite le grand saut pour arriver dans les années 1960 et 1970. « La bombe solaire » (1966), de Walter Ernsting (le créateur de Perry Rhodan), a été retenue non pour sa qualité intrinsèque, mais pour illustrer la dépendance de cette science-fiction allemande d’avec sa maîtresse d’outre Atlantique. Cette histoire de lutte entre l’humanité et une espèce extra-terrestre est en effet très classique, non dénuée d’incohérences (comment la bombe humaine parvient-elle à s’introduire aussi facilement dans un des navires de la flotte extra-terrestre), et la psychologie de son personnage principal est tracée au marteau-pilon. « La belle et la bête » (1971) d’Ernst Vleck, est une nouvelle plutôt bien léchée, même si le choix de la narration à la deuxième personne du singulier peut agacer. Néanmoins, cette histoire, qui imagine une société d’amazones dans laquelle les hommes sont retombés à l’état sauvage, et se veut démonstration de la complémentarité entre les deux sexes, souffre d’une certaine pudibonderie et de quelques remarques témoignant d’un sexisme soft.
Plusieurs textes déclinent l’esprit critique d’une époque, avertissant sur les possibles évolutions de la technoscience et de la société industrielle. « Anatomie de la peur » (1979), de William Voltz, est aussi court que percutant, imaginant une banque d’organes abritant les cerveaux d’individus refusant de mourir, mais qui attendent vainement qu’on leur compose un nouveau corps… « Les enclaves » (1977), d’Herbert W. Franke, relève pour sa part du thème de l’écologie et de la destruction de l’environnement par une société malade de ses déchets. Et on ne peut qu’être marqué par cette réflexion qui anticipe sur la géo-ingénierie, avec l’apparition d’une variété d’êtres humains adaptés à un environnement dégradé (« non seulement nous économisons les frais nécessaires à la protection de l’environnement, mais nous trouvons en même temps une source de revenus supplémentaires fort intéressante (…) », pp.128-129). Du même, « Les grandes manœuvres » (1977) est une nouvelle implacable, qui se veut illustration de la malédiction guerrière, ou comment, en une ère de paix, la guerre peut être réactivée sur une simple différence de couleurs de cheveux… Aussi effrayant que fataliste.
Au rang des dystopies écologiques, on trouve également le terrible « Les autres » (1969) de Wolfgang Jeschke, proche dans son ambiance de Lovecraft, et qui entretient ses énigmes autour du danger de l’énergie nucléaire, ainsi que le « Projet N.O.E., ténèbres et azur » (1978), d’Hermann Ebeling, variante nettement plus prévisible de l’arche de Noé, qui pèse par sa noirceur littéralement implacable. Sur ce plan, « Epines de lumière » (1975), de Gerd Ulrich Weise, est sans doute un des plus beaux textes du recueil. Il s’agit là encore d’une Terre post-apocalyptique, brûlée par le soleil, mais qui possède une beauté singulière, tel que la perçoit un survivant devenu aveugle : inventivité des perceptions, esthétisme flou de cette mutation d’origine humaine devenue forme de vie dominante, « Epines de lumière » distille un magnétisme attachant.
« L’île » (1974), de Reinhard Merker, frise même le pamphlet politique, à travers son portrait d’un bourgeois hédoniste, qui fuit les soucis du monde sur une île privée, en compagnie de jumelles consentantes, avant de se voir rattrapé par la révolution prolétarienne en marche… Relèvent également de cette tendance fortement engagée les nouvelles de Gerd Maximovic et Harald Buwert. « Premier amour » (1962) peut être analysé comme une variante sur le thème de 1984, avec lequel il partage des similitudes sensibles, ou comment les sentiments, même combattus avec force, connaissent une inévitable résurgence ; le fait que ce soit des extra-terrestres qui dominent cette société dystopique amoindrit malheureusement l’impact du texte. « La démonstration » (1977) de Gerhard Zwerenz en est assez proche, à ceci près que les extra-terrestres sont remplacés par des robots, soucieux de comprendre l’humanité, quasiment éteinte ; son manque d’originalité fait vite oublier cette nouvelle. Quant à « Autoexpérimentation » (1974), d’Harald Buwert, il s’agit d’une mise en abyme, recul assez intellectualisé sur la manière dont la société, le système dominant, conjure la menace d’une révolution venue des jeunes générations.
Avec « Le conseiller du dessous » (1960), de Peter von Tramin, on touche plutôt au fantastique qu’à la science-fiction, cette histoire d’un homme croyant vivre un rêve ne brillant pas par son originalité. « Une mission pour Lord Glouster » (1958) d’Alfred Andersch évoque dans un premier temps le voyage dans le temps, un des protagonistes ayant été le contemporain de Jeanne d’Arc, mais le doute fait plus que subsister sur la réalité de ce transfert, sans parler de cet elliptique retour possible de Jeanne… Un tableau contrasté, qui réserve donc de très belles surprises, et permet de mieux appréhender une science-fiction encore trop méconnue.
 Wagoo
Wagoo