Accueil > TGBSF > S- > Superfuturs
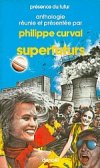 Superfuturs
Superfuturs
dimanche 14 août 2016, par
Philippe CURVAL (1929-)
France, 1986
Denoël, coll. "Présence du Futur", 320 p.
En 1978, Philippe Curval avait fait paraître Futurs au présent, une anthologie de jeunes auteurs parmi lesquels certains avaient débuté une prolifique carrière, à commencer par Serge Brussolo. Huit ans plus tard, le même remet le couvert en proposant dix-neuf nouvelles signées de débutants, un bilan d’étape qui, avec le recul, apparaît malheureusement surtout comme une épitaphe.
Bon nombre sont des critiques acérées de la société française d’alors et de ses perspectives. « Le brasier des faiseurs d’anges », de Cédric Debarbieux, est ainsi une illustration du culte de l’individualisme et de l’hédonisme égoïste, en plus de dénoncer un certain goût pour la perfection de sa progéniture au sein d’une société plus compétitive que jamais. Glaçant. De même, « Vidéo gratias ! » de Jean-Paul Couthier est une parfaite illustration du décervèlement généré par la télévision, à travers cet individu au vocabulaire appauvri et rempli de formules répétitives qui sont autant de mantra, se gorgeant d’écrans sur un mode pseudo interactif et récréatif. « La bande 08 » d’Anne Matalon peut en être rapproché, dans la mesure où l’auteure dénonce le poids croissant de la publicité sur nos vies via une mouvance anti-pub affublée du terme infamant s’il en est de terroristes (on est alors au crépuscule d’Action directe) et d’un mode opératoire délicieusement onirique. Sur un mode plus humoristique, « La guerre des Bières » d’André Cabaret (sic !) est la description d’un affrontement décomplexé entre fossoyeurs rivaux, dans un monde où la religion est devenue la valeur refuge (une extrapolation du basculement provoqué par la victoire du fondamentalisme en Iran), ou comment mettre en scène l’affrontement destructeur et contre-productif des rivalités religieuses, poussées ici jusqu’au non-sens ; on notera en tout cas la préfiguration plutôt bien vue du développement des communautarismes.
Autre nouvelle baroque voire barrée, « Frappe, ordure, frappe » (clin d’œil au Brûle, sorcière, brûle d’Abraham Merritt ?) de Joël Couttausse, qui, au-delà d’un affrontement désormais ritualisé et grand guignolesque entre représentants des deux blocs, interroge sur la dépendance croissante vis-à-vis des ordinateurs (« L’humain n’est pas prêt, n’a jamais été prêt à assumer le Libre Arbitre (…) Mais crois-moi, les Calculateurs, ces chères machines, travaillent de toute leur puissance pour l’aider à y parvenir », p. 99). On retrouve une problématique similaire dans « Euphoria » de Laurent Kolpak, qui met en scène un monde virtuel dont un des personnages finit par devenir prisonnier, prisonnier d’illusions que subit également une jeune journaliste, qui a eu le malheur de découvrir les expériences menées sur cobayes humains par le laboratoire Bayer (une dénonciation du capitalisme qui perd de sa force par son caractère un peu trop caricatural).
Mais le plus beau texte de l’anthologie est sans doute celui de Colette Fayard. « L’anniversaire » est une splendide évocation d’une histoire d’amour, de ses espérances jusqu’à son enlisement dans l’incompréhension mutuelle, à travers un voyage temporel effectué par le couple vers la plage cadre de leur première rencontre, et qui se déroule en décalage pour les deux protagonistes. On est là dans un univers proche du Je t’aime, je t’aime d’Alain Resnais, servi par une plume pleine d’émotions et d’authenticité, de poésie aussi. Dans un tout autre genre, l’irrésistible « L’escaladeur » signé Chica prend la forme d’un conte sur le sens d’un autre monde pour tourner en ridicule les idéologies religieuses et les politiciens qui s’accrochent au pouvoir telle des moules à leurs rochers, avec une chute franchement hilarante. « Humain, trop humain », de Michel de Pracontal, s’inscrit également de plein fouet dans cette veine délirante et humoristique, avec son image d’une Terre peuplée de post-humains dégénérés dirigés par un dictateur aussi génial que mégalomane, et où finalement, ce qui reste de meilleur de notre humanité n’est pas son héritage culturel mais son apparence accorte !
« Paris », de Pierre-Louis Malosse, est plus elliptique, avec son enquête sur le meurtre d’un certain Ronald Mitterrand : les nombreuses références à des personnages historiques, utilisées simplement comme des marqueurs gratuits, bien que volontiers absurde, donne l’impression de tourner à vide, et cette Terre qui semble dominée par des extra-terrestres nommés les Homards, avec des enclaves dédiées à diverses époques passées, n’est qu’un décor partiellement brossé en arrière-plan. Cette tendance à privilégier la forme sur le fond, l’altérité d’une intrigue sur sa résolution, est encore plus sensible dans « Le visage trop net » de Guy Grudzien, pourtant pourvoyeuse de jolies images -ce visage féminin sculpté sur le sable- et d’une indéniable charge poétique, mais dont on peine à identifier les tenants et les aboutissants (métaphore d’une histoire d’amour impossible ? Du drame de la guerre ?). « Symphonie bleue d’une visite patiemment attendue », de Patrick Leclère, relève des mêmes limites, entre amour rêvé et parasitisme extra-terrestre, tout comme « La maison de l’araignée » de Wildy Petoud et sa maison transchronologique que visitent des personnages plus allumés les uns que les autres, et « Le concentrique » de Claude Ber, visite dans un bâtiment énigmatique par le pouvoir du verbe, qui semble également s’apparenter à une plongée dans soi-même et dans une réalité qui n’est que construction. Pour être plus explicite, « Farandole » de Dominique Defert est également une métaphore de notre vie humaine, condamnée à l’aliénation, une vision à la limite du nihilisme.
Dans le registre de la fantasy, « Pericola » de Dominique Sage fait preuve de beaucoup de dérision dans la description de la quête initiatique de ce héros malgré lui au destin programmé de roi : fuite devant un adversaire plus fort que lui, efforts pour briser le carcan des poncifs du genre, au risque de s’avérer finalement un peu vain. « Hexadrame », de Pierre Thellier et Jacques Vallerand, se situe au croisement de la science-fiction et du fantastique : science-fiction par sa dimension uchronique, une campagne de France qui tourne au désastre pour la Wehrmacht, et fantastique par sa révélation finale non explicitée. L’intérêt des deux auteurs pour les wargames, qui est au cœur de leur texte, nous vaut malheureusement de trop pointilleux développements techniques sur les chars d’assaut en particulier, ce qui amène en tout cas à apprécier le caractère réduit de la nouvelle. Très court également, voire même un peu frustrant car manquant en l’état de suffisamment d’originalité, « Complainte pour un garçon oublié » de Gérard Dupriez ressemble fort à un des derniers feux de la science-fiction militante des années 70, avec son tableau d’un enfant atteint de malformations que l’on suppose d’origine radioactive. Il en est d’ailleurs de même pour « Futur C.V… No future », de Vincent Antoine, alors lycéen, qui décrit une société dans laquelle la durée de vie est sous le contrôle de l’Etat, jusqu’à une explosion de révolte qui passe par la violence.
 Wagoo
Wagoo