Accueil > TGBSF > T- > Tolkien, les univers d’un magicien
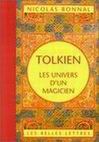 Tolkien, les univers d’un magicien
Tolkien, les univers d’un magicien
dimanche 30 décembre 2001, par
Nicolas BONNAL
France
Les Belles Lettres, 1998, 288 p.
La déferlante née autour du Seigneur des anneaux, et liée à la sortie du premier long métrage de Peter Jackson cette fin d’année 2001, ne doit pas nous inciter à tomber dans l’adoration béate. Sur Wagoo !, nous n’avons pas l’habitude de laisser notre sens critique sur une lune périphérique de Gazool III. Une étude comme celle de Nicolas Bonnal ne peut donc que nous intéresser. Son but est de décrypter l’œuvre magistrale de Tolkien, véritable nouvelle mythologie inspirée en grande partie des sagas scandinaves et de la Bible, matinées d’influences celtiques. La description de la vie finalement assez conventionnelle de l’auteur, qu’il définit comme un " anarchiste réactionnaire ", permet sans surprise de situer la création de Tolkien dans la filiation romantique, le rêve irréaliste d’un retour à un mythique âge d’or, celui de la communion entre nature et culture ; Mordor incarne dans cette optique les forces jugées destructrices de la révolution industrielle. Au contraire, la Comté représente une micro-société idéale, que l’on peut même rapprocher d’une communauté anarchiste.
Mais Nicolas Bonnal ne s’arrête pas à cette dimension métaphorique. Il passe au crible de son analyse les diverses créatures imaginaires créées par Tolkien, dont les ents sont sans doute parmi les plus originales, reflet à son avis de la lutte des sexes qui s’épanouissait dans les dernières années de la vie de l’auteur. Les héros et les différentes races qui peuplent la Terre du milieu sont également étudiés, et l’antropophobie de Tolkien est ainsi mise en valeur, tout comme sa vision quelque peu simpliste de la bonté et du mal visibles dans le physique des individus (le nec plus ultra étant les grands blonds, elfes en particulier... hum...). Quand au déclin concomittant des races les plus anciennes, comme les elfes et même les nains, c’est un thème commun à la mythologie celtique (voir une illustration récente dans Le crépuscule des elfes et ses deux suites, de Jean-Louis Fetjaine).
Les univers d’un magicien aborde également la problématique cruciale de l’initiation, aussi bien celle des mages (Saroumane s’arrêtant à mi-chemin, et Gandalf la poursuivant jusqu’au bout en finissant par surpasser son supérieur hiérarchique, à la suite de son combat contre le Balrog et sa transmutation de Gandalf le gris en Gandalf le blanc) que celle des hobbits et des autres compagnons de l’anneau. La figure d’Aragorn est d’ailleurs particulièrement mise en relief, incarnation de l’archétype royal, tout comme Arthur. On se permettra par contre une remarque : lorsque Nicolas Bonnal s’interroge sur la contradiction qu’il y a à voir Gandalf sauvé par un aigle féérique et la communauté contrainte de se déplacer par voie de terre pour aller jeter l’anneau dans la montagne du destin, il oublie justement cette dimension initiatique ; pour atteindre à une certaine sérénité, le moyen (le voyage et ses épreuves) compte autant, sinon plus, que la fin (la destruction de l’anneau).
Dans sa dernière partie, " Cosmogonies " (il utilise aussi malicieusement le terme de chaosmogonies), il se penche sur les constantes de malédiction, de trahison et d’épouvante, ainsi que sur la notion clef de crépuscule, qui sous-tend en particulier les trois tomes du Seigneur des anneaux (et que l’on retrouve d’ailleurs dans l’ambiance du premier volet de la trilogie de Jackson). Son étude, même si elle laisse inévitablement sur sa faim le fan de Tolkien, reste enrichissante ; elle doit toutefois être de préférence précédée par la lecture du magnum opus du maître, ainsi que du Silmarillion, pour pouvoir apprécier toutes les références et les interprétations permises par la culture érudite de Nicolas Bonnal. On ne peut qu’espérer que d’autres études universitaires de ce type trouvent le chemin du grand public...
 Wagoo
Wagoo